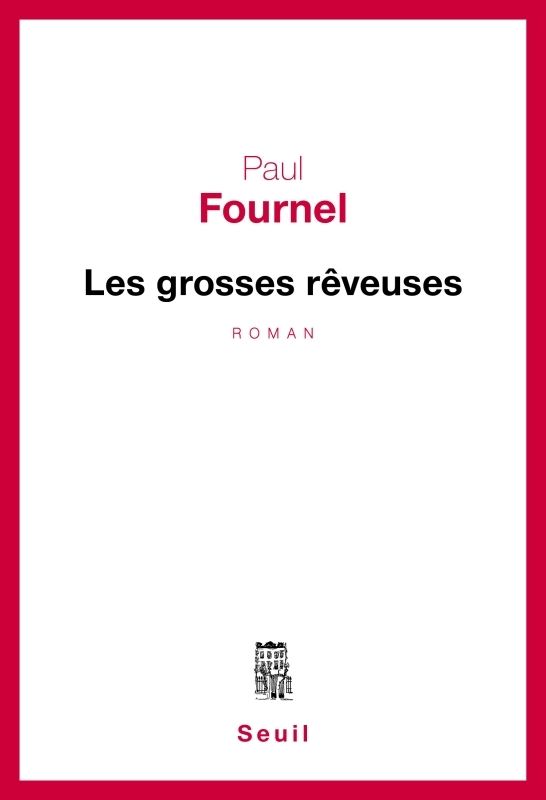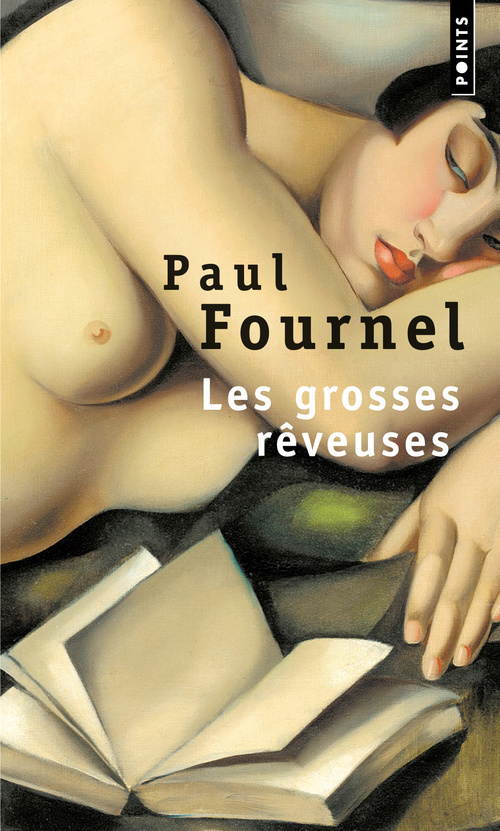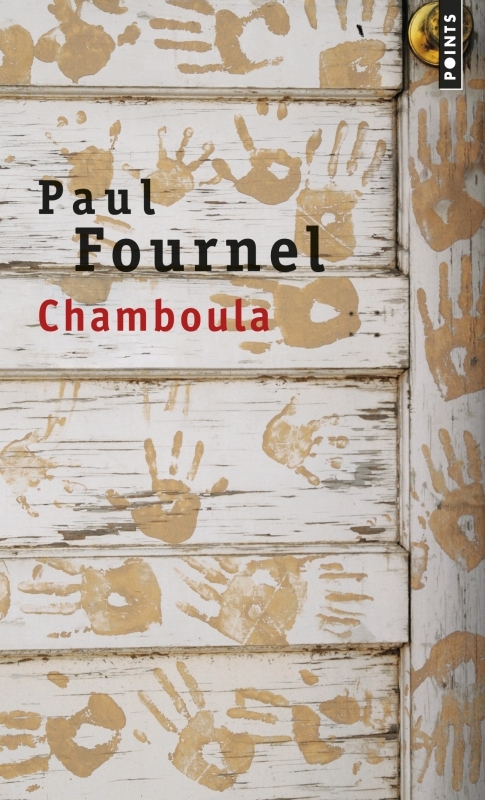De novembre 2000 à juin 2003, j'ai vécu au Caire. Cinq fois
par semaine, chaque petit matin et sans jamais faillir pendant plus
de cinq cents jours, j'ai donné des nouvelles à quatre-vingt-dix-huit
amis. Je me levais tôt. J'écrivais à la main. Je tapais sur mon écran.
J'envoyais. Sans me retourner, sans me lire ni me relire. Le reste du
jour, je me tenais sur le qui-vive, guettant la chose vue, vécue ou
entendue, qui serait le «poil de cairote» du lendemain.
Je ne savais rien de l'Égypte et je m'y trouvais soudain pour travailler.
Je me doutais simplement que c'était un ailleurs fort. De
moi, je savais que j'étais une machine occidentale assez finement
réglée et que j'enchaînais sur quatre années passées à San Francisco.
On ne pouvait guère rêver changement plus radical, ni surtout
changement plus radicalement inscrit dans l'Histoire en train de se
faire. Mon attention ne s'est pas portée sur les grands mouvements
historiques, pas davantage sur le passé de l'Égypte, encore moins
sur les mystères fumeux qui enrobent la recherche archéologique
lorsqu'elle prétend racoler le grand public. Tout cela m'a intéressé,
mais ce n'est pas ce dont je voulais entretenir mes amis. Je souhaitais,
plus banalement, leur donner un regard quotidien sur
Le Caire, dire ce que je voyais avec mes yeux malhabiles et partisans
d'occidental, et le faire avec une régularité de métronome qui
garantissait une certaine présence des intermittences du coeur, des
sautes d'humeur, des semaines creuses et des jours pleins.
Paul Fournel